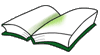| Titre : | Registres émotionnels et processus politiques (2017) |
| Auteurs : | Christophe Traïni, Auteur |
| Type de document : | Article : Article de revue |
| Dans : | Raisons politiques (n°65, 2017/1) |
| Article en page(s) : | 15 pages |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
science politique
sciences sociales sociologie |
| Résumé : | Depuis quelque temps déjà, il n'est pas rare d'entendre dire que les sciences sociales, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie et la science politique, seraient gagnées par un emotional turn ouvrant une nouvelle phase de leur histoire. Certes, une expression de ce type a le mérite d'inviter les chercheurs à se préoccuper de questionnements longtemps tenus pour anecdotiques et marginaux. ourtant, elle présente également le risque de postuler une nouveauté radicale là où il s'agit, en fait, de répondre à des questions anciennes en articulant un peu mieux des ordres d'analyse jusqu'alors dispersés. Cette dispersion, comme chacun sait, doit souvent aux spécialisations qui tendent au cloisonnement des études relevant de disciplines telles la physiologie, la psychologie, les perspectives historiques et sociologiques, lesquelles se distinguent plus encore des approches normatives qui caractérisent la philosophie ou le droit. À cela s'ajoute le fait qu'à l'intérieur de chaque discipline, les différents domaines d'étude peuvent s'avérer très inégalement enclins à s'intéresser aux dimensions émotionnelles de leur objet. À une échelle plus fine encore, et pour prendre l'exemple de l'étude des mobilisations, l'histoire des paradigmes qui ont marqué ce domaine rend parfois difficile la conjonction de ce qui relève de l'analyse des ressorts des engagements individuels, des opérateurs de coordination de l'action collective, et enfin des rapports aux institutions spécifiquement politiques. Or, l'un des principaux mérites de l'attention croissante accordée aux émotions réside précisément dans la manière dont elle nous invite à articuler ces trois types de questionnements qui tendent encore trop souvent à être traités de manière disjointe. Bien évidemment, il ne peut être question, pour autant, de s'en remettre aveuglement à l'idée d'une transdisciplinarité supposée ne présenter que des vertus. En matière de recherche, les logiques disciplinaires ne présentent pas que des désavantages pour peu que l'on saisisse bien les complémentarités de ce qui est prioritairement traité par les unes ou les autres. Ce dossier que Raisons politiques a décidé de consacrer aux émotions politiques constitue d'ailleurs l'occasion de montrer dans quelle mesure la thématique des émotions politiques permet de traiter de manière renouvelée un questionnement récurrent : à savoir celui des rapports entre, d'une part la philosophie et la théorie politique, et d'autre part les perspectives sociologiques. Bien sûr, d'innombrables travaux, à l'image de ceux de Luc Boltanski et Laurent Thévenot, ont déjà largement démontré l'utilité de développer des études au croisement de la philosophie et de la sociologie. De fait, il s'agira ici plus modestement de focaliser notre attention sur les réflexions soulevées par le chapitre introductif de ce dossier. Dans ce chapitre, Crystal Cordell mobilise les savoirs faires propres à la philosophie morale et à la théorie politique afin de caractériser les propriétés, aussi bien phénoménologiques et sociales, qui permettent de distinguer des états affectifs tels que le dégoût, l'indignation ou la pitié. Ce faisant, il s'agit bien là de mettre en exergue les logiques alternatives qui distinguent des registres émotionnels, c'est-à-dire des assortiments d'états affectifs interdépendants qui commandent des modes spécifiques de perception et de réaction à l'égard de certains objets et situations. Mon propos consistera donc à souligner en quoi de telles entreprises d'identification des propriétés des registres émotionnels sont particulièrement utiles à une sociologie des engagements et des mobilisations soucieuse d'interroger les rapports entre états affectifs et processus politiques. Loin de m'hasarder à discuter, en non spécialiste, du point de vue de la philosophie, je m'efforcerai plutôt de montrer dans quelle mesure l'approche théorique des émotions peut parfois s'enchâsser au c ur même des processus qui conduisent des individus à coordonner leur action en vue de faire valoir une cause collective [1]. Conformément à mon habitude, que certains pourraient assimiler à un indéfectible réflexe positiviste, je m'obligerai à étayer mon propos sur les observations empiriques que j'ai pu relever auprès des promoteurs de la protection animale. |
| Fonds : | Courant |
Nom de la Bibliothèque
Se connecter
- Productions de la cellule documentation
- Publications du parlement
- Podcasts
-
Ressources web
- Institutions parlementaires de Belgique
- Institutions parlementaires internationales
- Partis politiques représentés au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- Législation
- Administrations et institutions
- Sites de vérification de l'information / Education aux médias
- Egalité des chances / Egalité des genres
- Infos pratiques
Adresse
Nom de la Bibliothèquevotre adresse
votre code postal Ville
France
votre numéro de téléphone
contact