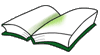| Titre : | Le droit à l’inclusion, toutes choses inégales par ailleurs (2024) |
| Auteurs : | Alexandre Sotirov, Auteur |
| Type de document : | Article : Article de revue |
| Dans : | Education et sociétés (n°52, 2024/2) |
| Article en page(s) : | 19 pages |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
enseignement inclusif
égalité des chances |
| Résumé : |
Besoins éducatifs particuliers et entrée à l’école
Depuis quelques dizaines d’années, en Suisse romande comme en France, le partenariat entre acteurs venant de différents horizons (professionnels ou non) et impliqués dans le traitement d’un problème partagé s’est imposé comme un mot d’ordre de l’action publique (Bordiec & Sonnet 2020). Les questions relatives à la scolarité ne sont pas épargnées par cette injonction (Payet, Deshayes, Rufin & Pelhate 2018 ; Scalambrin & Ogay 2014). L’entrée à l’école des enfants identifiés comme ayant des besoins éducatifs particuliers (iBEP) tombe sous ce régime de collaboration. D’un point de vue institutionnel, ces enfants sont généralement catégorisés “avec des besoins éducatifs particuliers” ou “présentant des besoins éducatifs particuliers”. À ces désignations officielles, celle d’iBEP leur est préférée puisqu’elle permet, tel que le propose Bodin (2018) à propos du handicap, de désolidariser la catégorie médico-administrative à laquelle se trouve affilié l’enfant d’un désordre développemental sous-jacent et indirectement de ne pas oublier les controverses animant le travail d’identification. L’entrée à l’école des enfants iBEP est donc supposée faire l’objet d’une opération de concertation à laquelle parents et professionnels sont appelés à participer en tant que partenaires pour s’accorder sur les possibilités de scolarisation. L’instauration d’un partenariat entre ces protagonistes est envisagée, par les acteurs de l’action publique ainsi que par certains chercheurs, comme une manière de donner plus de place à la voix parentale (Kalubi & Angrand 2020) et comme une opportunité pour les professionnels de s’ouvrir à d’autres façons de travailler et de penser (Amaré 2022). Il devrait en somme permettre “l’actualisation des ressources et des compétences de chacun” (Bouchard & Kalubi 2006, 52). Néanmoins, des recherches menées en milieu scolaire (en France ou ailleurs) soulèvent les impensés de cette injonction et les problématiques pouvant s’y loger. D’une accentuation de la vision déficitaire des parents les moins familiers des normes de collaboration attendues (Delay 2013, Glasman 1992, Payet & Giuliani 2014) à la légitimation de l’emprise sur le jeu scolaire de ceux qui y sont le plus investis (Baeck 2010, Périer 2005) en passant par une opacification des rôles professionnels (Baluteau 2017, Chartier & Payet 2014) et une fragmentation de l’organisation scolaire (Devos 2022), ces recherches montrent que le travail en partenariat peut aussi éprouver les acteurs et maintenir, voire accentuer, des rapports de pouvoir ou certaines inégalités. Cette enquête, pour comprendre comment des parents et des professionnels/intervenants désignés partenaires travaillaient ensemble pour préparer l’entrée à l’école des enfants iBEP, s’inscrit dans cette perspective. Luttes, controverses, négociations, épreuves s’y sont révélées les maîtres-mots et il a semblé heuristiquement fécond de prendre appui sur la métaphore de l’arène proposée par Strauss (1992, 277) pour qualifier ces points de rencontres où les représentants de divers mondes sociaux “se débattent, négocient, se battent, exercent contraintes et manipulations à propos de questions diverses” pour obtenir gain de cause. Or la cause en jeu est l’accès au droit à l’inclusion au sens d’éviter l’orientation vers une école spécialisée. Il s’agit d’un droit que les politiques éducatives suisses romandes promeuvent, mais qui semble, à l’instar de la France (Le Laidier 2017, Zaffran 2018), inégalement accessible selon l’appartenance de classe des enfants iBEP (Bovey 2022, Sotirov 2022). |
| Fonds : | Courant |
Nom de la Bibliothèque
Se connecter
- Productions de la cellule documentation
- Publications du parlement
- Podcasts
-
Ressources web
- Institutions parlementaires de Belgique
- Institutions parlementaires internationales
- Partis politiques représentés au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- Législation
- Administrations et institutions
- Sites de vérification de l'information / Education aux médias
- Egalité des chances / Egalité des genres
- Infos pratiques
Adresse
Nom de la Bibliothèquevotre adresse
votre code postal Ville
France
votre numéro de téléphone
contact