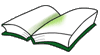| Titre : | Le modèle des élections de second ordre revisité (2025) |
| Auteurs : | Laurie Beaudonnet, Auteur ; Céline Belot, Auteur |
| Type de document : | Article : Article de revue |
| Dans : | Politique européenne (N° 86, 2024/4) |
| Article en page(s) : | Pages 6 à 26 |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : | élections européennes |
| Résumé : | Historiquement considérées comme des «élections de second ordre», les élections européennes ont souvent été le lieu de revendications principalement nationales et de votes de protestation à mi-mandat, sans qu’une véritable compétition européenne s’y joue. Ces élections étant perçues par les citoyens comme moins importantes que les scrutins nationaux, car n’exerçant qu’une influence limitée sur les grandes décisions politiques, la participation électorale y est traditionnellement plus faible, la couverture médiatique moins importante et l’engagement des partis y est réduit. Pourtant, à une époque marquée par de fortes préoccupations économiques, d’importantes tensions géopolitiques et des remises en cause des normes démocratiques, l’enjeu des élections européennes de 2024 a pu apparaître plus important que jamais. La reprise économique après la pandémie de COVID-19, la maîtrise de l’inflation et les transitions énergétiques ont constitué des questions clés dans les débats publics. Les gouvernements nationaux et les institutions européennes ont dû faire face à une pression croissante pour trouver un équilibre entre la stabilité économique et la prise en compte des enjeux environnementaux, tandis que les électeurs exigeaient de plus en plus que des mesures soient prises pour atténuer les difficultés financières et répondre aux préoccupations en matière de sécurité énergétique. Le conflit en cours en Ukraine et ses implications pour la sécurité européenne, l’approvisionnement en énergie, et les migrations ont été au premier plan. Les inquiétudes concernant le recul de la démocratie et la désinformation avaient été des questions clés au cours des années précédentes, reflétant un malaise croissant quant à la santé des systèmes démocratiques à travers le continent. |
| Fonds : | Courant |
Nom de la Bibliothèque
Se connecter
- Productions de la cellule documentation
- Publications du parlement
- Podcasts
-
Ressources web
- Institutions parlementaires de Belgique
- Institutions parlementaires internationales
- Partis politiques représentés au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- Législation
- Administrations et institutions
- Sites de vérification de l'information / Education aux médias
- Egalité des chances / Egalité des genres
- Infos pratiques
Adresse
Nom de la Bibliothèquevotre adresse
votre code postal Ville
France
votre numéro de téléphone
contact