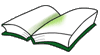| Titre : | De la démocratie participative, à la croisée des chemins (2020) |
| Auteurs : | Marc Crépon, Auteur |
| Type de document : | Article : Article de revue |
| Dans : | Pouvoirs (n°175, 2020/4) |
| Article en page(s) : | Pages 31 à 42 |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : | démocratie participative |
| Résumé : | C’est peu dire que le quinquennat qui s’est ouvert en 2017 a donné une actualité particulière à ce que Paul Ricœur appelait « le paradoxe du politique ». Ce dernier, en effet, n’est nulle part autant manifeste que dans l’exercice périlleux du pouvoir, en temps de crise, à travers aussi bien les attentes que les résistances liées aux décisions prises par les gouvernements. D’un côté, la responsabilité politique ne saurait s’exercer autrement que dans son pouvoir de décider ; de l’autre, les mesures que mettent en place les gouvernants qui ont été choisis pour les prendre sont nécessairement vécues par ceux auxquels elles s’appliquent comme des dispositions plus ou moins arbitraires, plus ou moins justes, de leur existence, quelle que soit la légitimité des instances qui les leur imposent. Dans tous les domaines de la vie (la santé, l’éducation, le travail, la justice, la sécurité), le pouvoir fait ses choix, qui sont eux-mêmes contraints par les institutions, nationales et internationales. Il n’est pas concevable, au demeurant, qu’il n’en aille pas ainsi. Nous n’en attendons pas moins de son action au moment où, par le biais d’un vote démocratique, nous nous en remettons à lui pour instaurer des protections que nous exigeons de recevoir en chacun de ces domaines. Nul en réalité ne désire, pas même le plus farouche de ses opposants, un gouvernement qui se révélerait incapable d’agir et donc de décider, et rien ne lui serait plus préjudiciable que l’inertie, l’impuissance ou la paralysie. |
| Fonds : | Courant |
Nom de la Bibliothèque
Se connecter
- Productions de la cellule documentation
- Publications du parlement
- Podcasts
-
Ressources web
- Institutions parlementaires de Belgique
- Institutions parlementaires internationales
- Partis politiques représentés au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- Législation
- Administrations et institutions
- Sites de vérification de l'information / Education aux médias
- Egalité des chances / Egalité des genres
- Infos pratiques
Adresse
Nom de la Bibliothèquevotre adresse
votre code postal Ville
France
votre numéro de téléphone
contact