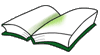| Titre : | Pourquoi les narratifs de gauche ne touchent plus les classes populaires ? : Le cas de la Belgique francophone |
| Auteurs : | Jérôme Van Ruychevelt Ebstein, Auteur |
| Type de document : | Brochure |
| Editeur : | Bruxelles : Fondation Ceci n'est pas une crise, 2025 |
| Format : | 48 p. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
gauche (science politique)
science politique élections 2024 |
| Résumé : |
" Pourquoi la gauche ne parvient-elle plus à parler à une partie des classes populaires ? Pourquoi ses discours, autrefois mobilisateurs, sont-ils aujourd’hui parfois rejetés par une partie de celles et ceux qu’elle prétend défendre ?
Face à la montée des populismes identitaires et de l’extrême droite, les analyses se sont souvent concentrées sur les stratégies gagnantes de ces courants antidémocratiques et sur les raisons qui poussent les classes populaires à voter pour eux. Ce court essai propose un changement de perspective : et si la gauche avait elle-même perdu sa capacité à parler au cœur des gens ? L’auteur explore les failles narratives de la gauche, en faisant le lien entre psychologie sociale et analyses sociologiques matérialistes. Son terrain d’analyse est la Belgique francophone et s’appuie sur les discours diffusés lors de l’année électorale 2024. L’analyse montre comment les collectifs et les organisations progressistes ont perdu un lien social et affectif qui les connectait aux classes populaires, et comment cette déconnexion explique en grande partie l’échec de ses narratifs. Elle avance notamment l’idée que la gauche cherche trop à convaincre par des arguments rationnels et des principes éthiques froids, oubliant que la mobilisation repose sur des expériences vécues, des émotions partagées et des cadres mentaux adaptés. Ce texte est une invitation à repenser ensemble les stratégies de la gauche sur le champ de la bataille culturelle. Il ne s’agit pas seulement de porter un regard critique, mais d’ouvrir des pistes concrètes pour reconstruire une parole politique qui rassemble, qui touche et qui gagne durablement". [Extrait de la publication] |
| Note de contenu : |
PARTIE I : La droite a gagné les classes populaires 6
Le contexte politique 7 « Classes populaires » : de qui parle-t-on ? 9 PARTIE II : La déconnexion du terrain 11 L’implantation dans les classes populaires 12 La disparition progressive du maillage social ouvriériste 12 La pensée individualiste est devenue la pensée intuitive 13 La création d’une élite culturelle de gauche désancrée 15 PARTIE III : L’impact de cette déconnexion sur nos narratifs 17 Le manque d’affect 18 Les deux langues 18 La langue froide, c’est celle des dominant·es 18 Le piège de vouloir « parler juste » 19 Les frames et les cadres moraux 19 Les cadres moraux qui ont gagné 21 Les cadres moraux qui ont perdu 22 Le manque d’écoute 23 Le manque de « personnalités ponts » 24 Le manque de récit 24 Les émotions primitives 24 Nous ne générons pas de pouvoir d’agir 25 Le manque d’un récit cohérent 27 C’est qui les méchant·es ? 29 La vulgarisation des causalités systémiques 30 Une compréhension vécue plutôt qu’une analyse abstraite 31 Une traduction simplifiée des enjeux systémiques 31 L’émotion et l’expérience avant l’analyse rationnelle 31 PARTIE IV : Se réancrer pour mieux raconter 32 Le terrain, le seul avantage comparatif de la gauche 33 La bataille pour les frames 34 Pour un « circuit court émotionnel » 35 Créer des expériences sur le terrain : oui mais comment ? 37 Mobilisations locales 38 Repenser les espaces de socialisation 38 Être présent en période de crise 40 Innover dans la démocratie locale 40 Former les bases sociales 41 De nouveaux visages 41 Décentralisation pour un mouvement massif 41 Pour une union des narratifs de gauche 42 Une même vision morale du monde 43 Exemples de dénominateurs communs narratifs 44 Le mot pour la fin 48 |
| Fonds : | Courant |
Nom de la Bibliothèque
Se connecter
- Productions de la cellule documentation
- Publications du parlement
- Podcasts
-
Ressources web
- Institutions parlementaires de Belgique
- Institutions parlementaires internationales
- Partis politiques représentés au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- Législation
- Administrations et institutions
- Sites de vérification de l'information / Education aux médias
- Egalité des chances / Egalité des genres
- Infos pratiques
Adresse
Nom de la Bibliothèquevotre adresse
votre code postal Ville
France
votre numéro de téléphone
contact