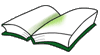| Titre : | Pouvoirs, n°174 - 2020/3 - De Gaulle |
| Type de document : | Bulletin : Numéro de revue |
| Paru le : | 04/09/2020 |
| Année de publication : | 2020 |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Charles de Gaulle a-t-il jamais douté de la France, de son identité, de sa pérennité, de son rôle et de sa grandeur ? La question paraît incongrue. « On ne peut pas aimer la France plus qu’il l’a aimée », dira son vieil adversaire, François Mitterrand, au jour de sa disparition. La question paraît incongrue mais elle s’impose dès la lecture de la première page des Mémoires de guerre et l’amour ne fait rien à l’affaire. La France y est bien sûr présentée comme l’objet de la révérence personnelle la plus sacrée et est exaltée comme une candidate naturelle à la direction générale du monde. La nature exceptionnelle du pacte qui lie la patrie du général de Gaulle à l’Histoire avec un grand H se voit affirmée sans ambages. Et pourtant l’inquiétude n’est pas loin. De Gaulle est l’homme du tout ou rien. La France a vocation à la grandeur et la Providence l’a de toute éternité destinée à la première place mais si elle manque le coche – et après quatre années d’occupation allemande on voit bien ce que ça veut dire –, patatras, tout s’effondre et nous voici sans transition passés au temps des « malheurs exemplaires ». L’allusion à l’exemplarité nous rassure bien un peu car elle nous dit que l’abonnement à un destin providentiel n’est pas résiliable et que « la lueur de l’espérance » ne finit jamais de briller tout à fait, fût-ce au fond de la nuit la plus noire. Il n’empêche : l’impression qui se dégage de ces lignes est celle d’une intense précarité. L’avenir de la France paraît se jouer à quitte ou double. L’inquiétude est proportionnelle au niveau des enchères et celles-ci ne sont pas médiocres : la plus haute destinée comme condition incontournable de la survie. En somme, la première place ou rien ! |
| Fonds : | Courant |
| En ligne : | https://droit.cairn.info/revue-pouvoirs-2020-3?lang=fr |
Nom de la Bibliothèque
Se connecter
- Productions de la cellule documentation
- Publications du parlement
- Podcasts
-
Ressources web
- Institutions parlementaires de Belgique
- Institutions parlementaires internationales
- Partis politiques représentés au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- Législation
- Administrations et institutions
- Sites de vérification de l'information / Education aux médias
- Egalité des chances / Egalité des genres
- Infos pratiques
Adresse
Nom de la Bibliothèquevotre adresse
votre code postal Ville
France
votre numéro de téléphone
contact